
De quoi avoir peur ? Cette question nous concerne tous parce que nous avons tous peur. Plus ou moins peur, mais aucun mortel qui se pense mortel ne vit sans elle, puisque notre peur principale est celle de cesser de nous sentir être, et que nous appelons mort cet anéantissement. Et peut-être même que nous avons rencontré la peur au moment même de notre naissance, peut-être que nous sommes nés avec elle. Aujourd’hui, la mort est partout, qu’elle explose dans des bombes, brûle dans des forêts, se tapisse dans des maladies, qu’elle assèche, qu’elle gèle, qu’elle affame ou qu’elle joue aux jeux politiques et cruels de la division planétaire. Nous vivons dans le monde de la peur. Mais qui l’a fait, ce monde ? Nous. Serait-ce donc que la peur nous plaît ? Dans le cas contraire, qu’est-ce que nous avons mis en place pour en sortir ? Avons-nous travaillé toutes les options ? On ne peut échapper efficacement à un danger que s’il est clairement déterminé. Observons donc précisément quels dangers nous assaillent et comment la peur s’installe dans nos vies. Est-elle temporaire ? Est-elle durable ? Voyons nos stratégies et celles des sociétés devant elle et osons dresser un constat lucide. Mais commençons par un tour du côté du vocabulaire, et par observer ce qu’elle est.
Il suffit de regarder la pile de mots de son champ lexical pour avoir confirmation de la place de la peur dans nos vies. Du côté de la petite peur, nous aurons une légère appréhension, ou un peu d’inquiétude, ou un trac plus ou moins prononcé. Pour la grande peur, nous n’avons que l’embarras du choix : effroi, terreur, horreur, panique ou épouvante, jusqu’à la mort où nous traverserons les affres de l’agonie, pour ne rien dire de ce qu’il y a après et de l’angoisse de l’enfer. Je vous fais grâce de toutes les familles de mots de chacun de ces noms, genre terrifiant, horrible ou épouvantable. Voulons- nous parler de peurs bien installées ? Voici l’insécurité, l’angoisse et l’anxiété. Nous sommes envahis de tics et de TOC, ou entravés dans les phobies les plus diverses, les névroses et les hantises. Nous pouvons aussi être craintifs par nature depuis la naissance, poltrons, pleutres, lâches, pusillanimes, ou simplement timides et timorés. L’argot n’est pas en reste de vocabulaire bien sûr, étant historiquement le vocabulaire des marginaux qui vivaient dans la précarité, l’illégalité et le danger. On peut avoir un coup de flip ou un coup de pression, la trouille, les foies ou les jetons, ou simplement les chocottes, la frousse et la pétoche. Le vocabulaire nous le dit sur tous les tons : tenons-nous sur nos gardes. C’est effarant !
nous parler de peurs bien installées ? Voici l’insécurité, l’angoisse et l’anxiété. Nous sommes envahis de tics et de TOC, ou entravés dans les phobies les plus diverses, les névroses et les hantises. Nous pouvons aussi être craintifs par nature depuis la naissance, poltrons, pleutres, lâches, pusillanimes, ou simplement timides et timorés. L’argot n’est pas en reste de vocabulaire bien sûr, étant historiquement le vocabulaire des marginaux qui vivaient dans la précarité, l’illégalité et le danger. On peut avoir un coup de flip ou un coup de pression, la trouille, les foies ou les jetons, ou simplement les chocottes, la frousse et la pétoche. Le vocabulaire nous le dit sur tous les tons : tenons-nous sur nos gardes. C’est effarant !
Les psychologues ont rangé la peur parmi les émotions, au même titre que la joie, l’amour, la tristesse ou la colère. La caractéristique d’une émotion est de commencer par un évènement extérieur qui nous entraîne dehors, c’est-à-dire que ça nous tire hors de nous-mêmes jusque dans l’émotion appropriée à la situation. Un deuil nous entraîne dans la tristesse, un cadeau d’anniversaire dans la joie, ou alors nous serions des robots sans les couleurs  de la vie. L’étymologie du mot émotion le dit exactement : une émotion c’est ce par quoi on est bougé ex, hors de, c’est à dire hors de notre assise, hors de notre assiette diraient les cavaliers. Le sens apparaît encore plus clairement dans le terme é-mu, qui est mu hors de. L’émotion nous meut, elle nous émeut, même. D’ailleurs c’est une expression courante que de dire : ‘Il était hors de lui’ en parlant de quelqu’un de furieux. Ajoutons que puisque nous sommes agis par l’émotion, nos réactions aux émotions ne dépendent pas d’un choix délibéré et conscient mais d’un ensemble de modifications qui s’emparent de nous en fonction des circonstances. Dans ces conditions, il n’y a pas plus à nous féliciter d’être heureux de notre cadeau qu’à nous reprocher d’être en colère.
de la vie. L’étymologie du mot émotion le dit exactement : une émotion c’est ce par quoi on est bougé ex, hors de, c’est à dire hors de notre assise, hors de notre assiette diraient les cavaliers. Le sens apparaît encore plus clairement dans le terme é-mu, qui est mu hors de. L’émotion nous meut, elle nous émeut, même. D’ailleurs c’est une expression courante que de dire : ‘Il était hors de lui’ en parlant de quelqu’un de furieux. Ajoutons que puisque nous sommes agis par l’émotion, nos réactions aux émotions ne dépendent pas d’un choix délibéré et conscient mais d’un ensemble de modifications qui s’emparent de nous en fonction des circonstances. Dans ces conditions, il n’y a pas plus à nous féliciter d’être heureux de notre cadeau qu’à nous reprocher d’être en colère.
Pour nous recentrer sur l’émotion de peur, les neurosciences et les éthologues en ont beaucoup étudié les effets sur notre comportement et notre physiologie. La réponse de la peur au danger est automatique, la part de notre réflexion y est quasiment inexistante. La nature sait bien que si le danger presse, une démarche genre « Voyons voir, je me demande s’il ne vaudrait pas mieux que je prenne mes jambes à mon cou » serait parfaitement inadéquate. Ce ne serait probablement plus la peine de nous poser la question. Donc, que nous soyons humains ou animaux, si la peur survient, elle nous saisit. Retrouvant l’étymologie latine où pavor signifie ‘être frappé d’effroi’, on peut dire que la peur nous frappe. Quelle que soit notre activité, nous la suspendons, nous nous immobilisons. Mais pourquoi ? Pour être en alerte générale maximale et savoir d’où vient le danger, pour nous orienter et pouvoir décider si nous devons fuir, faire le mort ou attaquer. En un mot, pour survivre.
Notons que  nous sommes moins armés que les animaux à l’état naturel. Nous ne pouvons pas cacher naturellement notre fuite derrière un nuage d’encre, comme la seiche. Le hérisson, en plus de ses piques, émet une substance assez puante pour éloigner n’importe quel agresseur doué d’un tant soit peu de bon sens, et à part quelques pétomanes, pas nous. D’autres, comme les lièvres, les girafes ou les kangourous sont imbattables à la course, pas nous. A cela ajoutons l’art de l’immobilité et du silence absolus. Chez les humains seuls les maîtres en arts martiaux et certains chasseurs en sont capables. A première vue, nous sommes dépourvus de plusieurs atouts que la nature a distribué aux animaux devant le danger. Du coup, nous sommes plus vulnérables aux dangers et plus sensibles à la peur.
nous sommes moins armés que les animaux à l’état naturel. Nous ne pouvons pas cacher naturellement notre fuite derrière un nuage d’encre, comme la seiche. Le hérisson, en plus de ses piques, émet une substance assez puante pour éloigner n’importe quel agresseur doué d’un tant soit peu de bon sens, et à part quelques pétomanes, pas nous. D’autres, comme les lièvres, les girafes ou les kangourous sont imbattables à la course, pas nous. A cela ajoutons l’art de l’immobilité et du silence absolus. Chez les humains seuls les maîtres en arts martiaux et certains chasseurs en sont capables. A première vue, nous sommes dépourvus de plusieurs atouts que la nature a distribué aux animaux devant le danger. Du coup, nous sommes plus vulnérables aux dangers et plus sensibles à la peur.
Au premier signal de peur, l’amygdale, à ne pas confondre avec celles que nous avons au fond de la gorge, l’amygdale donc, provoque en nous plusieurs modifications physiologiques d’urgence. Le système nerveux sympathique sonne l’alarme et déclenche la sirène comme dans les films de guerre. Ça sonne dans nos surrénales ! Notre vigilance s’accroît : si la peur ne dure pas trop longtemps, le cerveau s’active. Nos pupilles se dilatent pour nous permettre de mieux voir les menaces. Une partie de notre sang quitte le haut du corps et descend dans le bas, parce que c’est là où se trouvent nos jambes, je ne vous l’apprends pas. De plus il y a une augmentation de nos capacités de coagulation, très utile en cas de blessure légère. Notre cœur se met à battre plus vite pour soutenir nos efforts en cas de fuite. On peut comme le dit l’expression populaire pisser dans sa culotte et même davantage, mais c’est pour s’alléger s’il fallait fuir. Il n’est pas rare que nos poings se crispent un peu inconsciemment. Poussons le mouvement, nous aurions vite le poing fermé en cas d’attaque. Seulement, le corps redistribuant les énergies dont nous disposons, d’autres processus s’arrêtent. L’intelligence de la nature pose des priorités et comme la digestion n’a plus aucun sens pour un cadavre, elle met le système digestif en sommeil.
pour soutenir nos efforts en cas de fuite. On peut comme le dit l’expression populaire pisser dans sa culotte et même davantage, mais c’est pour s’alléger s’il fallait fuir. Il n’est pas rare que nos poings se crispent un peu inconsciemment. Poussons le mouvement, nous aurions vite le poing fermé en cas d’attaque. Seulement, le corps redistribuant les énergies dont nous disposons, d’autres processus s’arrêtent. L’intelligence de la nature pose des priorités et comme la digestion n’a plus aucun sens pour un cadavre, elle met le système digestif en sommeil.
Les sensations de ce branle-bas de combat ne font pas que nous déplaire. Nous aimons donc jouer à nous faire peur, à condition d’être certains que cela n’a pas lieu d’être. La fête récente d’Halloween avec ses sorcières, ses déguisements horribles et ses films d’horreur à la pelle en sont une illustration. La peur que nous savons injustifiée dans la réalité met notre corps dans un état d’excitation à peu de frais et comme nous sommes sûrs que nous retrouverons nos pantoufles à la fin du film, nous sécrétons les hormones du plaisir : endorphine, dopamine, sérotonine. Ajoutons qu’il est bien possible que parfois une catharsis ait lieu, c’est à dire une sorte de purification psychologique. En effet, les monstres que nous voyons à l’écran ont quelque chose à voir avec nos monstres intérieurs. Leurs dérèglements vibrent avec nos torsions secrètes qui se trouvent mises en lumière et peut-être même exorcisées par le film.

Dans tous les autres cas, la peur et sa chaîne de réactions au danger est quand même un processus coûteux pour l’organisme. Elle est prévue pour être temporaire, le temps que nous répondions au danger, puis elle s’efface afin que le système parasympathique rétablisse la détente et l’harmonie. Lorsque le chien a quitté la maison et que le chat l’a bien vérifié, son effroi cesse et il reprend son territoire. La peur qui l’avait poussé à prendre la fuite reflue, la nature remet de l’ordre dans son organisme, il va manger un peu et ronronner sur un coussin du salon. Il a retrouvé l’usage de son estomac et le plaisir du sommeil. 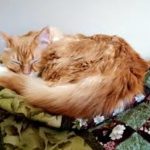 Mais que se passe-t-il quand nous nous trouvons dans les conditions d’une peur qui dure ?
Mais que se passe-t-il quand nous nous trouvons dans les conditions d’une peur qui dure ?
Il y a hélas trop d’occasions d’être installés dans un état de peur chronique. Que nous vivions en pays de guerre, comme l’Afghanistan depuis des décennies, que nous soyons contraints à la migration ou simplement enfermés dans une famille maltraitante. L’enfant maltraité vit en état de constant éveil autour de la menace, explique Boris Cyrulnik. Il est prêt à décoder telle crispation de la mâchoire par exemple pour se raidir devant les coups qui vont s’abattre, puisqu’il n’a pas le choix de la fuite. Toute son attention est focalisée là, tout le reste lui est étranger. Le paysage, les leçons à l’école, et même le reste de la famille. Quand une peur dure, la vie se restreint et se resserre autour de la cause du danger. Le chien battu se terre ou attaque quand il voit un promeneur appuyé sur un bâton.
Les symptômes physiologiques et psychologiques négatifs deviennent prédominants et s’étendent même aux plages de temps où nous pourrions goûter la vie. Comme on l’a vu sur des souris, la peur est très inhibitrice. Voici l’expérience. Dans un large périmètre non pas de sécurité, mais de liberté, on a lâché des souris normales et des souris contaminées aux modifications hormonales induites par la peur. Les souris naturelles se sont rapidement aventurées dans toute la surface à leur disposition jusqu’en son milieu pour vaquer à leurs occupations. Les autres sont restées terrées tout le temps de l’observation dans un coin ou le long des bords. Cette expérience était-elle si nécessaire à notre édification ? L’éthologie nous montre que lorsque nous nous trouvons en terrain jugé dangereux, c’est ce que nous faisons. Par exemple, nous évoluerons près du bord de la piscine ou agrippés à la rambarde de la patinoire si nous ne nous sentons pas en confiance. Pire, nous demeurons parfois paralysés, malheureux et crispés à l’endroit où nous nous serons trouvés. Quand bien même faudrait-il aller chercher de la nourriture, nous ne bougerions pas. Plutôt mourir !
la surface à leur disposition jusqu’en son milieu pour vaquer à leurs occupations. Les autres sont restées terrées tout le temps de l’observation dans un coin ou le long des bords. Cette expérience était-elle si nécessaire à notre édification ? L’éthologie nous montre que lorsque nous nous trouvons en terrain jugé dangereux, c’est ce que nous faisons. Par exemple, nous évoluerons près du bord de la piscine ou agrippés à la rambarde de la patinoire si nous ne nous sentons pas en confiance. Pire, nous demeurons parfois paralysés, malheureux et crispés à l’endroit où nous nous serons trouvés. Quand bien même faudrait-il aller chercher de la nourriture, nous ne bougerions pas. Plutôt mourir !
En d’autres termes, cette peur qui doit nous éloigner du danger si elle est temporaire devient source de danger lorsqu’elle dure. Lorsque nous nous rendons compte de ces dysfonctionnements, les psychologues nous disent que nous ajoutons à ce que nous vivons au moins deux autres souffrances, comme la culpabilisation et la honte, mais ce n’est pas de notre faute. La peur installée nous a plongés malgré nous dans un état d’inhibition et de confusion mentale, notre digestion laisse à désirer, notre aptitude au plaisir s’éteint, l’anxiété chronique que cela génère épuise le corps en général et les reins en particulier. Notre sommeil lui-même vire à l’insomnie et nos rêves aux cauchemars. C’est horrible et nous ne savons pas comment en sortir. La peur s’étend dans notre vie comme un cancer, nous laissant de moins en moins de place, et nous nous refermons sur un espace de plus en plus étroit. Les chercheurs en génétique ont remarqué que la modification de notre génome se met à chevaucher les génomes caractéristiques de la schizophrénie et des troubles bipolaires.
Une solution serait de considérer la raison de nos peurs et de retrousser nos manches, même des manches de colibri, pour que les dangers diminuent ou s’éloignent de nous et de tous. Il est de notre responsabilité d’en prendre conscience, si nous sommes en moins grande souffrance que d’autres qui ne peuvent pas agir. Et il nous faudra aussi veiller à l’esprit dans lequel nous agirons car ce n’est pas en ajoutant du noir à un tableau qu’on l’éclaircit. Il est clair que ces dangers que nous avons créés ne diminueront pas sans que nous ne nous mettions à les décréer.
s’éloignent de nous et de tous. Il est de notre responsabilité d’en prendre conscience, si nous sommes en moins grande souffrance que d’autres qui ne peuvent pas agir. Et il nous faudra aussi veiller à l’esprit dans lequel nous agirons car ce n’est pas en ajoutant du noir à un tableau qu’on l’éclaircit. Il est clair que ces dangers que nous avons créés ne diminueront pas sans que nous ne nous mettions à les décréer.
Pour reprendre mes exemples précédents, on ne peut laisser un enfant dans l’enfer. Si nous avons des doutes, avons-nous le courage et la compassion nécessaire pour intervenir ? Peut-on laisser un peuple entier sans secours ? Peut-on voir comme ces jours-ci des migrants qu’on est allé chercher par charters entiers être déposés devant la forêt biélorusse en direction de la Pologne, et puis savoir qu’effrayés et gelés, ils mangent des racines pendant plusieurs jours en traversant la forêt sans boire ? Peut-on entendre qu’ils sont accueillis à la frontière par les matraques de la soldatesque, qu’ils se font rompre les os et renvoyer de l’autre côté où on leur fait subir la même chose en leur interdisant le retour dans leur patrie ? Quelle peut être leur terreur au fur et à mesure des jours ? Que pensons-nous de ce macabre ping-pong politique ? Qu’est-ce que nous faisons ?
De quoi avoir peur ? Moi, j’avoue que j’ai peur de cet homme inhumain, de ces hommes débordant de folie furieuse tels qu’il se montrent ici et ailleurs. J’ai peur de leur cruauté, de leur errance telle qu’ils ne voient plus un semblable dans leur semblable, ni même un animal, ou quoi que ce soit de vivant. J’ai peur parce qu’ils se sont perdus de vue eux-mêmes et qu’ils n’ont peur de rien, ni de l’enfer qu’ils amènent sur la terre, ni de Dieu, ni du karma, ni d’eux-mêmes, peut-être seulement d’un maître comme un Caucescu ou un Bolsonaro, et ce maître n’est pas le mien. Pourtant, disent les Dialogues avec l’ange, il faudrait qu’ils aient peur, eux. Bien dosée, la peur aurait pu leur servir, au sens propre du terme, de garde-fou. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes dotés de lois : par la peur de la sanction, elles maintiennent les petits enfants que nous sommes sur une route compatible avec la circulation d’autrui, jusqu’à ce que nous ne garions plus sur la place du handicapé non pas pour économiser 135 euros mais par compassion.
peur de leur cruauté, de leur errance telle qu’ils ne voient plus un semblable dans leur semblable, ni même un animal, ou quoi que ce soit de vivant. J’ai peur parce qu’ils se sont perdus de vue eux-mêmes et qu’ils n’ont peur de rien, ni de l’enfer qu’ils amènent sur la terre, ni de Dieu, ni du karma, ni d’eux-mêmes, peut-être seulement d’un maître comme un Caucescu ou un Bolsonaro, et ce maître n’est pas le mien. Pourtant, disent les Dialogues avec l’ange, il faudrait qu’ils aient peur, eux. Bien dosée, la peur aurait pu leur servir, au sens propre du terme, de garde-fou. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes dotés de lois : par la peur de la sanction, elles maintiennent les petits enfants que nous sommes sur une route compatible avec la circulation d’autrui, jusqu’à ce que nous ne garions plus sur la place du handicapé non pas pour économiser 135 euros mais par compassion.
Nous avons aussi un autre chantier qui demande un autre courage, celui du contrôle de notre esprit. En effet, on sait aujourd’hui grâce aux neurosciences que penser à quelque chose est capable d’éveiller les mêmes zones du cerveau que la chose elle-même. De ce fait, lorsque nous pensons à un danger, même s’il n’y en a pas dans la réalité, pour nous il est bien là. Nous nous mettons à avoir physiquement et émotionnellement peur des dangers auxquels nous pensons, avec les mêmes conséquences que celles dont nous venons de parler. Ce qui n’est pas là gâche ce qui est là. Le danger virtuel avale le plaisir réel de l’instant. Nous souffrons. Nous ne nous rendons pas compte que nous interdisons aux mécanismes naturels de notre corps de s’exercer normalement parce que nous ignorons que notre évocation a le même poids pour notre cerveau que la réalité.
 Les dangers pensés sont de deux ordres, les uns sont déjà passés, et les autres pas encore là selon la direction de notre pensée. Vers l’arrière, la pensée réactualise un trauma et une peur passée qui n’a plus lieu d’être. Le chauffard a disparu depuis longtemps mais nous nous créons à nous-mêmes une nouvelle souffrance : celle de la remémoration, de la rumination qui finit par donner au trauma et au danger une continuité qu’il n’a pas dans la réalité. Nous sommes capables de nous infliger l’accident indéfiniment. L’autre désynchronisation porte sur l’avenir. On se met à redouter un danger qui n’est pas là et qui peut-être ne se présentera jamais. Parfois, la rumination du passé alimente la crainte de l’avenir et dans le cas du chauffard, nous redouterons tout ce qui a trait aux voitures jusqu’à nous pourrir l’existence. Il est pourtant statistiquement rarissime qu’une même personne soit victime de deux chauffards dans sa vie.
Les dangers pensés sont de deux ordres, les uns sont déjà passés, et les autres pas encore là selon la direction de notre pensée. Vers l’arrière, la pensée réactualise un trauma et une peur passée qui n’a plus lieu d’être. Le chauffard a disparu depuis longtemps mais nous nous créons à nous-mêmes une nouvelle souffrance : celle de la remémoration, de la rumination qui finit par donner au trauma et au danger une continuité qu’il n’a pas dans la réalité. Nous sommes capables de nous infliger l’accident indéfiniment. L’autre désynchronisation porte sur l’avenir. On se met à redouter un danger qui n’est pas là et qui peut-être ne se présentera jamais. Parfois, la rumination du passé alimente la crainte de l’avenir et dans le cas du chauffard, nous redouterons tout ce qui a trait aux voitures jusqu’à nous pourrir l’existence. Il est pourtant statistiquement rarissime qu’une même personne soit victime de deux chauffards dans sa vie.
En nous re-présentant les dangers, au premier sens du verbe re-présenter, en nous les présentant sans cesse à nouveau, nous les re-créons. Cette torsion de notre esprit est particulièrement visible dans le cas de la phobophobie : la peur d’avoir peur. Les personnes atteintes de crises de panique se mettent à avoir peur de nouvelles crises, au point de vouloir éviter des situations de plus en plus nombreuses et de s’enfermer dans une souffrance et une solitude de plus en plus oppressantes. Certains perdent dans cette maladie leurs amis, leur famille, leur travail. Or que se passe-t-il ? La pensée de la peur précédente crée la peur d’une prochaine peur. Ce qu’on nomme la phobophobie montre bien quel dysfonctionnement notre esprit a infligé à la nature. Au lieu d’être provoquée par un élément extérieur, c’est notre propre peur qui crée la peur, au lieu d’être temporaire, elle devient chronique, au lieu de nous sauver, elle nous tue. De quoi avoir peur ? De nos pensées donc, quand elles sont déréglées…

Ajoutons à toutes ces peurs celles qui sont simplement imaginaires et ne correspondent pas à ce que nous vivons. L’idée que nous avons des situations et des gens finit par les remplacer dans leur réalité – et c’est une autre raison d’avoir peur car nous nous mettons en danger en quittant une perception saine de la réalité. D’autre part, ça ne nous gêne pas d’avoir peur d’une chose et de son contraire en même temps. Par exemple nous avons peur du gendarme et peur du voleur quand bien même il n’y aurait pour nous de menace ni de l’un ni de l’autre. Nous avons peur de la solitude et peur des autres, même si pour l’instant notre quotidien est assez harmonieux. Nous avons peur de mourir et peur de vivre. Cette incohérence ne nous saute pas aux yeux, comment ça se fait ? Parce que nous y sommes habitués depuis des générations. Nos peurs ne concernent pas que nous, elles expriment aussi celles de nos ancêtres depuis la glaciation, comme le disait Freud dans des hypothèses dites phylogénétiques.
Je m’explique. Nos ancêtres devaient s’inquiéter des ours, des lions et des loups qui rôdaient devant leur caverne obscure et qui guettaient leur assoupissement pour les manger tout crus. Vous me direz que c’est fini depuis longtemps. Oui, mais non ! Parce que, est-ce que toutes nos cellules à nous sont au courant qu’il n’y en a plus, des ours ? Supposons que, réveillés dans leur sommeil par la griffe acérée d’un tigre, ils n’aient pas réussi à obtenir avant  leur mort soudaine une paix parfaite ni à insérer le calme et le pardon dans cette situation. Supposons que les générations d’après n’aient pas non plus traité la question, eh bien cette peur ancienne est susceptible de rester encore aujourd’hui quelque part dans nos inconscients. Nous avons peur sans le savoir. Ces évènements que nos ancêtres ont subis pendant des milliers d’années incitent l’enfant au coucher à vouloir de la lumière dans sa chambre comme un feu devant sa grotte, pour le préserver des monstres de la nuit.
leur mort soudaine une paix parfaite ni à insérer le calme et le pardon dans cette situation. Supposons que les générations d’après n’aient pas non plus traité la question, eh bien cette peur ancienne est susceptible de rester encore aujourd’hui quelque part dans nos inconscients. Nous avons peur sans le savoir. Ces évènements que nos ancêtres ont subis pendant des milliers d’années incitent l’enfant au coucher à vouloir de la lumière dans sa chambre comme un feu devant sa grotte, pour le préserver des monstres de la nuit.
C’est peut-être une des raisons pour lesquelles le virus du COVID est une menace indéniable plus lourde que la maladie elle-même. Au 14ème siècle et rien qu’en Europe, la Peste Noire a fait en cinq ans 25 millions de morts, c’est-à-dire, tenons-nous bien, une  personne sur trois. Prenons un instant pour nous représenter cette calamité, à partir du nombre des membres de notre famille par exemple, ou de celui de nos meilleurs amis. Vu la proportion et l’extension géographique, il est impossible que nos ancêtres n’aient pas été décimés eux aussi. Ainsi, cette pandémie réveille-t-elle des effrois épouvantables. Nous nous mettons à nous sentir menacés les uns par les autres. Certains refusent de se réunir désormais dans une même famille, on se brandit l’information des décès comme des arguments contradictoires. La ligne de démarcation des peurs entre provax et antivax divise au point que j’ai lu qu’il y a des gens qui redoutent qu’une nouvelle tension ne tourne à la guerre civile.
personne sur trois. Prenons un instant pour nous représenter cette calamité, à partir du nombre des membres de notre famille par exemple, ou de celui de nos meilleurs amis. Vu la proportion et l’extension géographique, il est impossible que nos ancêtres n’aient pas été décimés eux aussi. Ainsi, cette pandémie réveille-t-elle des effrois épouvantables. Nous nous mettons à nous sentir menacés les uns par les autres. Certains refusent de se réunir désormais dans une même famille, on se brandit l’information des décès comme des arguments contradictoires. La ligne de démarcation des peurs entre provax et antivax divise au point que j’ai lu qu’il y a des gens qui redoutent qu’une nouvelle tension ne tourne à la guerre civile.
Aujourd’hui, des études scientifiques appuient l’intuition de Freud. Elles prouvent que nos mémoires cellulaires véhiculent d’un âge à l’autre les souvenirs qu’on n’est pas arrivé à désactiver soi-même. Selon un article de Science et vie, une étude en Hollande a montré que suite à la famine due à un blocus allemand à la fin de la deuxième guerre mondiale dans une région de 4,5 millions de personnes, les bébés étaient nés plus petits et maigres, avec des tendances à l’anxiété et à diverses pathologie dans la suite de leur existence : en effet on sait maintenant que les émotions des mères agissent intra utero et modifient l’ADN des bébés. D’ailleurs les anciens le savaient déjà puisque aussi bien les philosophes grecs et latins que les anciens Chinois préconisaient que les femmes enceintes vécussent dans le calme et la beauté. Mais ce que l’étude hollandaise a découvert de plus surprenant, c’est que les enfants des bébés de 1945 devenus adultes, ont eu dans une proportion non négligeable les mêmes caractéristiques de poids à la naissance que leurs parents et qu’ensuite ils ont manifesté la même tendance à l’anxiété qu’eux. Pourtant il n’y avait nulle famine en Hollande dans les années 70. La peur avait modifié durablement le génome de ces familles. 
En d’autres termes, si nous croyons que nos peurs se limitent à celles dont nous sommes conscients, nous sommes probablement en train de considérer qu’un iceberg se limite à sa pointe. Ces peurs profondes et inconnues amoncelées depuis des générations façonnent pourtant et notre physiologie et notre psychologie, comme nous venons de le voir. Du coup, nous avons peut-être tort de penser que notre psychologie est une composante personnelle de notre identité. Une partie de notre caractère pourrait nous ramener à une mémoire de traumatismes extérieurs, acquise il y a plus ou moins longtemps. C’est une très bonne nouvelle, non ? Car ce qui a été ajouté peut être enlevé, comme je disais tout à l’heure que ce qui a été créé peut être décréé.
Prendre conscience qu’une partie de nos peurs, conscientes et inconscientes, nous ont été léguées et peuvent être abandonnées devrait donc éveiller en nous l’enthousiasme du bon ouvrier devant un beau chantier, et aussi l’angoisse de ne pas être à la hauteur de nos propres responsabilités par rapport à ceux qui viendront après nous. Alors, de quoi avoir peur ? De mourir avant d’avoir pris congé de chacune de nos peurs, pour ne plus en transmettre l’information.
En attendant que tout ça soit désamorcé, nous avons quand même besoin de refuges contre la peur pour nous sentir tant soit peu en sécurité. Dans la pyramide de Maslow, la sécurité du gîte et du couvert est à la base des besoins, rien ne peut se développer par dessus si cette base n’est pas stable, et les  yogis la place au chakra racine, en bas. Autrement dit, ce besoin est vital et touche l’ensemble de notre existence. Si nous n’en disposons pas, nous sommes contraints de chercher dehors cette sécurité qui nous manque. Et si d’aventure nous avons l’impression de la trouver dehors, quelle en sera la conséquence ? Eh bien nous allons devenir dépendant de ce refuge comme le chien dépend de son maître pour sortir de l’appartement. Seulement, cette dépendance nous asservit à ce qui nous rassure, et dès que nous nous sentons un peu sécurisés, nous nous mettons à éprouver une nouvelle peur : celle que ça change.
yogis la place au chakra racine, en bas. Autrement dit, ce besoin est vital et touche l’ensemble de notre existence. Si nous n’en disposons pas, nous sommes contraints de chercher dehors cette sécurité qui nous manque. Et si d’aventure nous avons l’impression de la trouver dehors, quelle en sera la conséquence ? Eh bien nous allons devenir dépendant de ce refuge comme le chien dépend de son maître pour sortir de l’appartement. Seulement, cette dépendance nous asservit à ce qui nous rassure, et dès que nous nous sentons un peu sécurisés, nous nous mettons à éprouver une nouvelle peur : celle que ça change.
Ceux qui ont moins peur que nous y ont vu un mirobolant moyen de gagner milliards et pouvoir. Pour nous protéger, nous achetons très cher des détecteurs de toutes sortes, des triples serrures et nous blindons nos portes. Nous entrons des codes compliqués pour la moindre démarche en ligne, nous prenons des assurances à qui mieux mieux, même pour un billet d’entrée au théâtre ou un trajet en train à 20 euros. Nous laissons nos libertés et notre intimité se réduire comme peau de chagrin et l’expression « Pour votre sécurité » est le sésame de toutes les prises de pouvoir. Pour notre sécurité, nos conversations sont susceptibles d’être enregistrées, nos valises sont susceptibles d’êtres ouvertes, nos statuts sur les médias sont susceptibles d’être censurés. C’est pour notre sécurité que les vitesses sont de plus en plus limitées et que nous payons des amendes à tire larigot pour excès de vitesse à 32 km à l’heure. Dans une rue proche de chez moi, la vitesse était limitée à 40km à l’heure et le détecteur me souriait lorsque je le longeais à 38. Maintenant que la limite a été descendue à 30, rouge de colère, il me montre les dents et clignote ‘Danger’ en grosses lettres. Il me fait peur ! Pour notre sécurité, nous votons des lois ou des décrets sécuritaires et liberticides, nous consommons des psychotropes. Tant que la peur générera plus de profit que d’embarras, cet emballement sécuritaire n’a pas de raison de s’arrêter. On le voit tous les jours dans le contenu des informations et les campagnes publicitaires.

Et ce n’est pas tout. Pour notre sécurité, nous devenons globalement inhumains, fous inconscients, au cœur de congélateur. Nous fermons les frontières aux misérables qui pourraient nous envahir parce que nous préférons les voir mourir ailleurs. Dans le désert, la montagne ou la mer, qu’importe, du moment que ce n’est pas chez nous. Pour notre sécurité nous dépensons dans l’armement un budget mondial qui suffirait à éteindre la faim et la pauvreté dans le monde mais nous avons préféré apprendre à regarder avec l’œil de l’indifférence les visages maigres, désespérés et salis par la misère. Et pourtant, comme le souligne Krishnamurti, il faut avoir l’esprit bien engourdi pour penser que la prolifération des armes de destruction aux mains de pays qui se détestent soit la meilleure solution pour la paix dans le monde, et que le pullulement des instruments de mort protégera la vie.
Et dans notre vie privée ? Dès que nous nous sentons en sécurité, notre dépendance est la même envers les personnes qu’envers les lois ou les objets. Si c’est dans un conjoint que nous trouvons refuge, notre amour se transforme aussitôt en tentative d’emprisonnement. La question « Tu m’aimeras toujours ? » est d’abord l’aveu d’une peur et donc hélas, la menace d’un contrôle à venir. C’est vrai, il nous faudra régulièrement vérifier le degré d’amour de l’autre comme on vérifie la température de la piscine. Pour que l’autre soit plus heureux ? Non, pour que nous nous vérifiions nos paramètres de sécurité. 
Dès que nous avons trouvé un abri extérieur à nous, surgit donc une nouvelle peur : la peur de le perdre. Nous nous accrochons et ça nous plonge dans une nouvelle souffrance, comme celle du patineur immobilisé à sa rambarde. Tout change sans cesse, et l’inconnu fourmille de dangers potentiels, surtout pour celui qui se sent seul. Si ça bouge, si la roue tourne, qui va me ramasser si je tombe ? Qu’est-ce qui m’attend au tournant ? L’aléatoire, l’incontrôlable, l’étranger. L’avenir en somme. La peur entraîne le réflexe de la saisie, du renfermement, de l’immobilisation et du contrôle. Mais cela nous met à côté de la vie parce que dans l’univers comme dans nos existences tout évolue, change, tourne et se déplace, il suffit de regarder le soleil du petit matin pour en avoir la preuve à midi.
La feuille d’automne détachée de son arbre, a-t-elle peur de la chute et de la décomposition ? La rivière a-t-elle peur de l’océan ? L’eau douce qui débouche dans le sel de cet espace sans rives ne peut pas remonter le courant. Nous, piégés par la peur, nous imaginons parfois que nous pouvons résister à ce mo uvement qui va inéluctablement vers sa fin, et emporte la nôtre. Nous posons des barrages pour endiguer nos peurs, pour rester loin de l’océan, mais tout le monde sait que les digues peuvent se rompre et les nôtres n’endiguent pas complètement nos peurs. D’ailleurs, comme le remarque Franck Lopvet, plus on attend quand on fait un barrage, plus la pression augmente et non pas l’inverse. La saisie, le barrage, la résistance ne sont donc pas des solutions. Au lieu de soulager, elles finissent par grossir notre malaise et si nos peurs se trouvent justifiées, elles accroissent la souffrance de la perte en ajoutant celle de l’arrachement.
uvement qui va inéluctablement vers sa fin, et emporte la nôtre. Nous posons des barrages pour endiguer nos peurs, pour rester loin de l’océan, mais tout le monde sait que les digues peuvent se rompre et les nôtres n’endiguent pas complètement nos peurs. D’ailleurs, comme le remarque Franck Lopvet, plus on attend quand on fait un barrage, plus la pression augmente et non pas l’inverse. La saisie, le barrage, la résistance ne sont donc pas des solutions. Au lieu de soulager, elles finissent par grossir notre malaise et si nos peurs se trouvent justifiées, elles accroissent la souffrance de la perte en ajoutant celle de l’arrachement.
Il découle de tout ça que nous devrions ajouter une peur à notre liste : celle d’avoir peur de ne chercher nos refuges qu’à l’extérieur parce qu’ils nous rendent dépendants, et surtout surtout, parce que la plupart du temps, ils sont inopérants sur le long terme. Pour répondre à notre besoin légitime et biologique de sécurité, nous avons besoin de placer notre confiance dans un flux continu d’amour, d’abondance, d’indulgence, de sagesse, de lucidité, de discernement. Et comme aucun pistolet d’alarme ne nous les donne, aucune personne non plus, nous continuons à avoir peur. Alors puisque vers le dehors nous ne trouvons pas de solution satisfaisante, pourquoi ne pas nous diriger dans l’autre sens, c’est-à dire vers l’intérieur de nous ?
Déjà, on découvre que ce n’est pas facile d’y aller, encore moins d’y rester. Notre esprit comme nos yeux regarde dehors parce que c’est ce que nous avons appris et nos ancêtres aussi. Nous devons nous lancer dans l’aventure de notre propre chef, avec bonne volonté et détermination. Ensuite, puisque nous avons repéré nos besoin d’amour, d’indulgence, de sagesse, de lucidité et de bienveillance, c’est cette ambiance que nous aurons à installer à l’intérieur pour pouvoir nous sécuriser. Et là, bien sûr, le bât blesse, parce que ce n’est pas exactement l’atmosphère que nous y trouvons, même à notre propre égard. 
A ce moment là commence une nouvelle révolution : celle de la conscience des choses sans parti-pris et de la validation de soi tel que l’on est. Nous avons peur ? Eh bien c’est ça, nous avons peur. Tout le vivant connaît la peur et nous aussi, il n’y a pas de vie sans souffrance et nous sommes vulnérables. Respirons un bon coup et balayons toutes les auto-condamnations que nous ajoutons à notre angoisse. Dépoussiérons la peur de tous ses corollaires : ne nous traitons plus de mauviettes et cessons de nous mépriser nous-mêmes. Ne nous laissons plus sombrer dans le désespoir au motif que nous n’arrivons pas à éradiquer notre peur, cela nous plongerait en plus au fond de la dépression. Ne marinons plus dans le jus du découragement, ne nous faisons plus de reproches comme si nous étions coupables de nos angoisses car la culpabilité coupe nos ailes et notre vaillance, au contraire, reconnaissons que nous avons beaucoup essayé. N’attendons pas non plus de résultat rapide comme un claquement de doigts et apprenons la patience envers nous et la persévérance. Choisissons d’être notre propre allié et de ne pas nous trahir. Et ensuite, comme disait Thérèse d’Avila à ses amies aux heures de la prière : « Au travail ! »
Entraînons-nous au voyage intérieur. Vu l’ampleur du travail à faire, il faut nous y consacrer entièrement, au moins quelques minutes par jour. C’est ce qu’on appelle la méditation. Ensuite, nous chercherons à exporter dans le quotidien les bénéfices de ce moment particulier et ce que nous entreprendrons pour guérir nos peurs en sera beaucoup plus efficace. Mais en attendant, explorons l’intérieur. 
Si nous méditons avec notre cerveau qui pense, nous rencontrerons à nouveau nos pensées. Ce ne sera pas vraiment de l’exploration ! Nous devons aller contre le Je pense donc je suis, qui prône que la pensée prouve l’être. Alors testons. Si Descartes a raison, dès que je ne penserai pas, j’arrêterai d’être. Les instructeurs transmettent qu’il est bon de guetter le silence entre les pensées pour nous rendre compte que dans cet espace, nous restons quand même vivants. En effet, assez vite nous nous apercevons que nous ne mourons pas entre deux pensées. Mais comment le savons-nous puisque nous ne pensons pas ? Parce que nous en avons conscience. Cette conscience est difficile à sentir car elle est toujours là, silencieuse et immobile. Dans la vie ordinaire, nous cessons de prêter attention aux objets qui sont toujours dans notre champ de vision. Alors, quand il s’agit de silence et d’immobilité, quelle chance aurions-nous eu de nous en apercevoir ?
Mais quand on lui accorde de l’intérêt et qu’on se place du côté de ‘ce qui se rend compte’ et non de ce qui est vu, nous voyons l’instabilité de nos pensées et des émotions qui passent au sein de cet espace. Elles se succèdent et parfois se répètent comme on voit toujours les mêmes chevaux de bois tourner sur un carrousel. Pendant que nous jouons sur ce manège, nous finissons par nous prendre pour ces émotions et les pensées qui passent et repassent, même si elles sont douloureuses. Nous nous prenons pour le cheval, identifiés à la matière. Nous sommes diagnostiqués objet, fût-il empli de peurs. A la fin du tour, tout le monde descend, game over.

Nous oublions que c’est un jeu facultatif, ou plutôt nous ne l’avons jamais su et si personne ne nous en informe, nous ne prendrons jamais conscience qu’il y a bien quelque chose qui se rend compte de tout ça, quelque chose en nous, calme et stable, quelque chose qui est nous puisque c’est bien nous qui observons. Tant que nous en restons ignorants, nous tournons avec le manège, le temps passe et nous emporte jusqu’à notre anéantissement. Mais commencer à entrevoir que nous sommes ces objets et aussi la conscience qui les baigne amorce un changement radical et invisible. La conscience est-elle impactée par l’arrêt du carrousel ? Non. Nous gagnons peu à peu en confiance en ce qu’elle est et nous nous centrons dans un état plus sécure. Don Ruiz dans le cinquième accord toltèque utilise la métaphore du spectateur au cinéma. Ce qui passe sur l’écran ne l’impacte pas et il sortira bien vivant de la salle après la mort du héros… Nous nous donnons donc la chance de mettre en lumière tous nos visages, tous nos rôles, toutes nos blessures dont la peur, toutes nos tactiques de contournement. De quoi parfois nous faire peur aussi, si nous n’étions pas réfugiés dans l’amour ! La sécurité que nous cherchons dehors contre les ricanements de notre anihilation, nous la découvrons à l’intérieur au fur et à mesure que nous prenons conscience de ceci : ce qui observe ne meurt pas.
En effet la conscience ne peut pas se casser. Il n’y a que les objets qui se cassent. Elle, elle est sans objet, comment serait-ce possible ? Formulons donc ainsi : puisque nous ne sommes pas seulement objet, notre vérité de base est incassable, invirussable, inenfermable. Libre. Si nous expérimentons cela, nous devenons libres : nous, dans notre véritable nature, nous sommes incassables, intouchables, inattaquables. Intuables. Tout simplement, nous sommes. Lorsque l’expérience se fait complètement, la peur disparaît complètement : de quoi aurions-nous peur si la mort n’en est pas une ? C’est pourquoi le Christ  n’y va pas par quatre chemins. Il dit chez Luc : « Je vous le dis à tous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. » Certes, nous quitterons notre corps, même sans être assassinés, mais c’est comme on sort d’un véhicule disent les bouddhistes, puisqu’il s’agit de revenir dans la liberté de cette intelligence aimante, chaude et claire qui a toujours été là et dont il faut faire l’expérience le plus tôt possible pour mourir en paix.
n’y va pas par quatre chemins. Il dit chez Luc : « Je vous le dis à tous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. » Certes, nous quitterons notre corps, même sans être assassinés, mais c’est comme on sort d’un véhicule disent les bouddhistes, puisqu’il s’agit de revenir dans la liberté de cette intelligence aimante, chaude et claire qui a toujours été là et dont il faut faire l’expérience le plus tôt possible pour mourir en paix.
Une question se pose alors : si la mort n’est rien, si la vie est inattaquable et invariable, agissons-nous comme il convient pour le bonheur de tous et de la planète pendant que nous sommes dans le temps de notre existence ? Ou alors la peur nous fait-elle rater ce que nous devrions faire pour nous-mêmes d’abord, et pour un monde plus vivable et beau ? Sommes-nous heureux, délivrés de nos fantômes ? Est-ce que nous montrons le courage que l’instant nous demanderait si nous habitions cet instant, si nous ne nous étions pas réfugiés dans l’ailleurs de nos pensées ? « Le vrai problème n’est pas de savoir si nous vivrons après la mort, disait Maurice Zundel, mais si nous serons vivants avant la mort.»
Ainsi, plutôt que de nous précipiter exclusivement vers les remèdes extérieurs contre la peur, exerçons-nous, prenons la direction du miracle, suivons la voie de la libération comme disent les indiens. Toute la question étant celle du comment ? voici une technique simple. Enfin, simple à expliquer. La voici. Avec quelle partie de notre corps pensons-nous ? Notre tête. Voulons-nous nous débarrasser de la pensée ? Suivons l’imagerie des saints décapités : enlevons-la. « Laissez le vent dissiper complètement votre tête, conseillent les sages. Visualisez-vous en face de vous sans tête. » Quoi ? Voici une pratique qui m’a placée directement en face de mes peurs. Une sorte de panique m’a prise devant cette consigne. Qu’allais-je devenir sans ma tête ? Finalement, chacun ses trucs, j’ai préféré la déposer à côté de moi gentiment à ma gauche en lui promettant que j’allais la reprendre très, très prochainement. Et pour respirer alors ? Devant l’affolement de l’asphyxie, je me suis vue obligée de descendre de ma tête pour imaginer des petites narines sur mon sternum et ma poitrine, et sentir que ça respir ait par le cœur, puis aussi par le ventre redevenu plus mobile. Lorsqu’on parvient à entrer tant soit peu dans cette pratique, notre cœur se délasse, il s’ouvre à plus d’amour, plus d’humanité. Notre corps s’assainit, le ventre s’assouplit et l’énergie peut s’y installer. Le cerveau inutilisé et même disparu se détend en sa propre absence et nos angoisses s’effacent.
ait par le cœur, puis aussi par le ventre redevenu plus mobile. Lorsqu’on parvient à entrer tant soit peu dans cette pratique, notre cœur se délasse, il s’ouvre à plus d’amour, plus d’humanité. Notre corps s’assainit, le ventre s’assouplit et l’énergie peut s’y installer. Le cerveau inutilisé et même disparu se détend en sa propre absence et nos angoisses s’effacent.
Au moment où tout ceci se produit, rendons-nous compte que nous avons toujours et plus que d’habitude la sensation d’être, qui ne dépend pas de notre histoire. Notre mémoire personnelle n’est donc pas la seule expérience possible. Apprenons donc à rester détendus dans la conscience comme un bébé contre sa maman, amour dans l’amour. A un moment peut-être, nous ferons l’expérience de ce que nous transmettent les sages : l’expérience de la connaissance. Mais !!! je suis Cela, ce vide plein de la physique quantique, cette intelligence inconcevable d’où ont surgi les objets et le temps ! Je suis avant, pendant et après le temps et les objets !! Ou comme disait Jésus : « Avant qu’Abraham fût, je suis ? »
Cette unité avec la conscience, dès que nous la ressentons même par bribes, nous ouvre un grand pouvoir pour nous et pour l’harmonie générale aussi. Peut-être nous sentons-nous faibles, pauvres, vieux, isolés, impuissants, inutiles devant les défis de notre époque ? C’est parfait. Parfait parce qu’il n’y a besoin ni de force, ni d’argent, ni de compagnie ni de puissance pour aller à notre rencontre. La force que nous découvrirons n’est pas la nôtre et c’est elle qui sera à l’œuvre. Tout se fera. Ainsi, au lieu de la devise infernale en application dans notre monde actuel : ‘Effroi, aveuglement, mort’, les Védas nous assurent que nos efforts vers l’intérieur nous donneront à tous l’Être, la conscience et la félicité : ‘Sat, chit, ananda’. Saisirons-nous la crise actuelle comme une opportunité pour aller d’une devise vers l’autre ?

